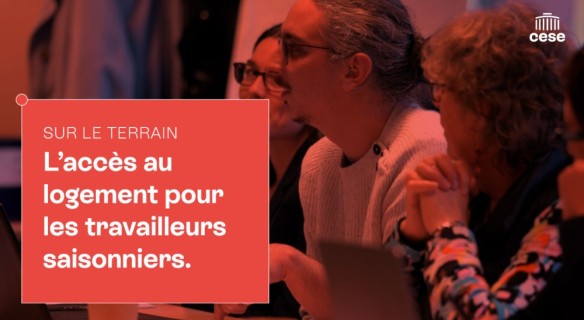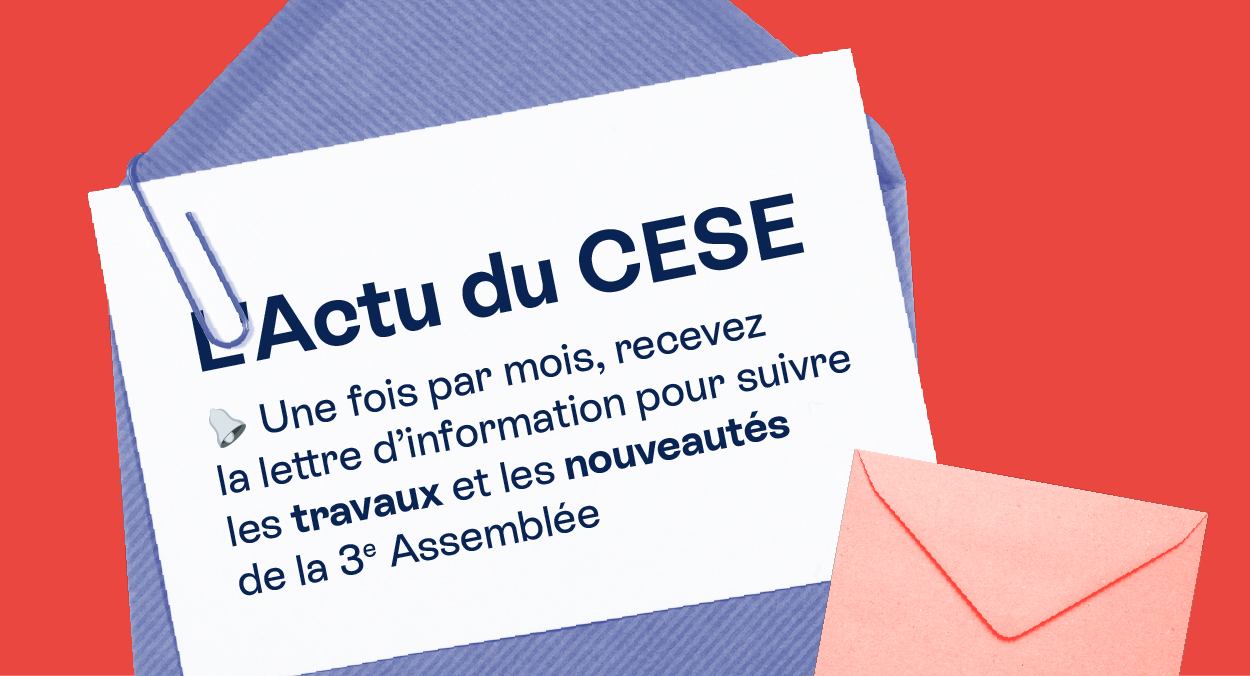Se loger dans les territoires pour exercer une activité saisonnière
Catégorie
Travaux et auditions
Date de publication
Formation de travail liée :
Sous-titre
Le CESE a adopté son avis
Chapeau
Tourisme, hôtellerie-restauration, animation socioculturelle et sportive, agriculture… De nombreuses activités nécessitent une main d’œuvre importante sur certaines périodes de l’année pour une courte durée. Le recrutement de travailleurs est indispensable pour l’économie des territoires qui dépendent d’activités saisonnières. De fortes disparités traversent ces territoires, qui possèdent chacun leurs singularités.
Corps
Sur la question du logement dans les territoires des travailleurs saisonniers, le CESE a adopté son avis en séance plénière le mercredi 29 mai 2024. Le texte a été adopté avec 84 voix pour, 10 contre et 24 abstentions.
Les préconisations ont été présentées par Catherine Lion (Groupe Agriculture), au nom de la commission Territoires, agriculture et alimentation. Mme Dominique Faure, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, était présente et intervenue lors de la séance plénière.
Lire l'essentiel de l'avis (2 pages)
Les difficultés d'attractivité du travail saisonnier
Le recrutement de salariés saisonniers en nombre suffisant et avec les compétences requises est de plus en plus difficile. Cette difficulté de recrutement est multifactorielle. Parmi les difficultés recensées : manque d’attractivité du métier lié à certaines conditions de travail souvent difficiles, niveau de rémunération parfois faible, mais aussi la difficulté à trouver un logement qui apparaît comme un obstacle majeur. En effet, offrir des solutions de logement satisfaisantes est déterminant pour recruter des saisonniers et donc pour assurer la pérennité d’une activité économique, essentielle dans les territoires concernés.
🔎 Le travail saisonnier peut revêtir différents types de contrats. Selon le ministère du Travail, il se caractérise par des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à peu près aux mêmes périodes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,) ou des modes de vie collectifs (tourisme…). Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur.
Traiter la question du logement des salariés saisonniers implique d’abord de connaître leurs besoins quantitatifs et qualitatifs, et donc de savoir combien et qui ils sont. Selon l’Insee, l’emploi saisonnier, destiné à répondre à un accroissement local et temporaire de l’activité économique, a représenté plus de 4 millions de postes en 2017.Ce type d’emploi occupe 2,5 millions de personnes, ce qui signifie que chaque saisonnier a en moyenne près de deux contrats par an.
Ces données statistiques, recueillies et traitées par l’Insee, permettent d’avoir une vision globale quant à la situation de l’emploi saisonnier en 2017. Toutefois, il s’agit d’une étude ponctuelle et il s’avère a priori impossible de disposer de tels éléments au fil du temps afin de pouvoir suivre les évolutions au niveau national. De nombreuses données existent, notamment via des études sectorielles et régionales, mais elles sont insuffisamment agrégées et diffusées.
Le logement pour les travailleurs saisonniers: des solutions qui rencontres des difficultés de mise en œuvre
« Nous savons bien que ces activités saisonnières sont au cœur de la dynamique de certains territoires et la question de l’hébergement est une clé essentielle de l’attractivité de métiers saisonniers. » explique Catherine Lion, rapporteure de l'avis. Ce constat peut s'illustrer à travers un chiffre clé :
40% des candidats à un emploi saisonnier dans le tourisme habitent loin ; faute de logement 100 000 ne concluent pas de contrat.
- l’absence au niveau central de l’État et à l’échelon territorial, d’une instance clairement identifiée chargée de piloter et de coordonner les politiques en matière de logement des saisonniers ;
- une forte concurrence pour l’accès au logement entre les saisonniers et les touristes, dans les territoires fortement marqués par la saisonnalité, en particulier en montagne et sur le littoral ;
- une inadéquation entre offre et demande. Ainsi, les zones où sont situés des logements vacants sont rarement celles où sont employés un nombre significatif de saisonniers ;
- une modification des normes qui ont été progressivement instituées pour garantir des conditions satisfaisantes d’hébergement adapté aux besoins des salariés saisonniers ;
- la sobriété foncière qui se concrétise par l’objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050, introduit par la loi Climat et Résilience d’août 2021, exige de privilégier la rénovation et la réhabilitation de l’existant ainsi que la réutilisation des friches même si incontestablement des besoins de construction existent. En effet, dans de nombreux territoires ruraux, les possibilités de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments existants, situés à proximité des exploitations agricoles, sont très limitées ;
- la non-reconnaissance du logement pour les saisonniers qui n’est ni un meublé de tourisme, ni une location en résidence principale à l’année ;
- la dimension financière, donc le modèle économique des projets, qui constitue un paramètre déterminant à la fois pour les saisonniers ainsi que pour les employeurs et les autres porteurs de projet.
De nombreuses solutions innovantes existent dans les territoires
Dans son projet d'avis, le CESE s'est intéressé à deux sortes d’espaces caractérisés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires dans sa récente typologie, basée sur des critères démographiques, économiques et géographiques :
- les ruralités productives, dont les habitants actifs sont majoritairement des ouvriers ou des travailleurs du secteur agricole ;
- les ruralités touristiques qui sont éloignées des pôles d’emplois et présentent, hors activités saisonnières, une faible densité de population permanente.
Pour le CESE les spécificités locales appellent des solutions adaptées à chaque contexte. Des initiatives innovantes existent au sein des différents territoires, c'est pourquoi la commission Territoires, agriculture et alimentation a souhaité les identifier.
« La question de l’hébergement des saisonniers se traite essentiellement au niveau local et il y a beaucoup d’initiatives sur le terrain » explique la rapporteure de l'avis.
Pour recenser des exemples des solutions de logements, une plateforme participative a été lancée permettant de recueillir les facteurs de succès et les difficultés rencontrées.
En parallèle, la commission Territoires, agriculture et alimentation s’est également déplacée sur le terrain, à Rennes, pour s’inspirer des initiatives déployées à l’échelle locale et mesurer l’importance des différents freins existants.
Plusieurs Conseils économique, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ont également contribué à l’avis pour apporter un éclairage territorial, indispensable sur le sujet du logement des travailleurs saisonniers ou en mobilité.
🔎 Dans sa note contributive au présent avis, le CESER Nouvelle-Aquitaine indique que 44% des saisonniers agricoles ne travaillent pas dans leur bassin de résidence. Il ajoute que pour ceux-ci, le problème de l’accès au logement est quasi insurmontable en raison d’une part de la rareté de l’offre locative et du coût, et d’autre part des très faibles revenu.
Pour Catherine Lion, « dans chaque territoire concerné par l’activité saisonnière (touristique et agricole) les acteurs trouvent déjà des solutions innovantes, en particulier les collectivités locales. ».
Une stratégie nationale pour le logement des travailleurs saisonniers qui accompagne les initiatives des acteurs des territoires
Les préconisations du CESE
Au croisement de différentes compétences et politiques publiques, la question du logement des saisonniers souffre d’un manque de pilotage clair, d’un manque de lisibilité des initiatives et aides existantes ou encore d’un manque de mutualisation entre les différents acteurs. Pour répondre à ces enjeux, qui sont étroitement liés, le CESE propose une approche transversale qui s’articule autour de 4 axes.
Renforcer la cohérence des politiques publiques
→ Par qui ? En identifiant un délégué interministériel du logement saisonnier chargé de coordonner l’élaboration d’une stratégie nationale ;
→ Comment ? En confiant un rôle de coordination aux régions (Président du Conseil régional et Préfet de Région) pour organiser la synergie entre les différents acteurs, y compris sur les mobilités, et mettre en œuvre le droit à expérimenter des solutions innovantes adaptées aux spécificités locales.
Créer un cadre d’action (législatif, réglementaire, fiscal…) pour favoriser l’hébergement des saisonniers
→ Comment ? En rendant éligible les logements des travailleurs saisonniers ou en mobilité aux mêmes aides et dispositifs applicables aux logements permanents (comme MaPrimeRénov’) ;
En régulant mieux les meublés de tourisme dans les zones tendues ;
En favorisant la remise sur le marché des logements vacants.
Accompagner le développement des projets collectifs mutualisés
→ Pourquoi ? Les projets collectifs permettent une mutualisation des solutions, par exemple : la mobilité, l’intermédiation… Ils peuvent être portés par des associations ou des groupements d’employeurs. Cette mutualisation doit se faire entre différents publics et de manière intersectorielle. Cela permet de répartir les charges financières et donc de renforcer la viabilité économique des projets.
→ Comment ? En encourageant les aides aux projets collectifs de logements d’actifs en mobilité, multi-filières ou multi-publics. En favorisant la coordination inter-secteurs, en particulier au niveau des groupements d’employeurs, et en valorisant le dialogue social pour mettre en place des solutions de logement innovantes.
Répondre aux attentes des salariés saisonniers
💡Un nombre important de salariés saisonniers ignorent quels sont leurs droits et les dispositifs, y compris d’aides financières, dont ils peuvent bénéficier.
→ Une solution : Généraliser la diffusion de vadémécums adaptés aux publics visés avec l’objectif de réduire les taux de non-recours aux aides existantes. Mieux répertorier et diffuser en temps réel les offres de logements disponibles pour les salariés saisonniers et organiser la mise en relationLa rapporteure
Catherine Lion a été directrice générale de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et est membre associée de la Chambre régionale d’agriculture d’Ile de France. Elle siège au CESE au titre du groupe de l’Agriculture et est membre des commissions « Territoires, agriculture et alimentation » et « Affaires européennes et internationales ».
Retour sur la séance plénière
Le projet d'avis a été présenté par Catherine Lion (Groupe Agriculture), au nom de la commission Territoires, agriculture et alimentation, lors de la séance plénière du mercredi 29 mai 2024 à 14h.
Une intervention de Madame la Ministre chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité
Mme Dominique Faure, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, est intervenue lors de la séance plénière.
« En France le travail saisonnier concerne près de 2,5 millions de personnes. Nous avons la responsabilité collective de les loger dans les meilleures conditions qui soient » a-t-elle introduit.
La Ministre a ensuite conclu : « Vous avez identifié de nombreuses problématiques et formulé de très pertinentes recommandations. Ce que vous proposez me semble extrêmement pertinent et mérite d’être exploré. »
Un table ronde de témoignages du terrain
Une table ronde a été organisée pour témoigner d'actions mises en œuvre dans différents territoires et secteurs d’activités avec :
- Mme Muriel Abadie, Vice-présidente de la région Occitanie en charge du Tourisme durable, des loisirs et du thermalisme, maire de Pujaudran (Gers)
- Mme Sabine Ferrand, restauratrice, représentante du CESER Centre-Val de Loire
- M. Olivier Mugnier, Délégué général de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs, ancien membre du CESE